
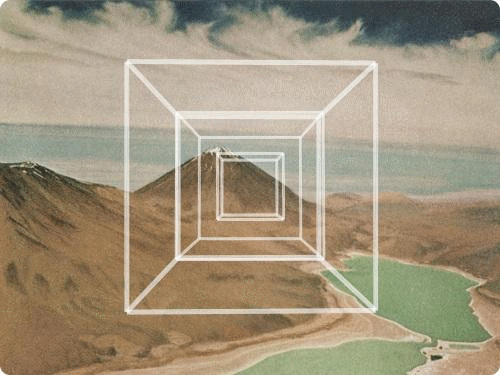

Carnet URFISTinfo1
2014-02-14
L’information n’a pas encore reçu beaucoup d’échos en France : et pourtant cela fait plusieurs mois maintenant qu’Elsevier demande régulièrement le retrait d’articles déposés par leurs auteurs sur le réseau social Academia. Si on le regarde sous l’angle de l’open access, cet exemple souligne incontestablement l’« injustice fondamentale de l’actuel écosystème de la communication académique » (John Dupuis). Mais il met également en lumière l’arrivée à maturité des réseaux sociaux académiques : à l’heure où Elsevier peine à se créer une place sur les outils 2.0 (échec de 2collab en 2011, rachat de Mendeley en 2013), il n’est pas étonnant que celui-ci attaque les nouveaux challengers qui se développent auprès des communautés académiques, après avoir laissé faire. Et ce n’est pas un hasard si Olivier Dumon, managing director chez Elsevier, vient de publier sur le Huffington Post un article intitulé « The Business of Science: Social Networking of Science » : ces challengers ne sont pas sans soulever, eux aussi, un certain nombre de questions.
Qu’ils soient outils de production et de diffusion de l’information (comme les wikis, les blogs ou Twitter) ou outils sociaux et de partage (comme les plateformes de contenus et les réseaux sociaux), le web 2.0 propose désormais des outils capables de répondre aux attentes et usages des chercheurs (Anatoliy Gruzd, Melissa Goertzen et Philip Mai, 2012). « Réseaux sociaux académiques », « réseaux sociaux scientifiques », « réseaux sociaux de chercheurs », « academic social networks »… Si les premiers réseaux sociaux numériques grand public se sont développés à partir de la fin des années 1990 et si les chercheurs ont d’abord utilisé Facebook, c’est seulement à partir de 2007-2008 qu’ils ont pu profiter de réseaux qui leur étaient spécifiquement destinés avec des caractéristiques propres à leurs besoins (CV, diffusion de documents, outils de visualisation, métries…) (Emma Bester) .
Ces réseaux se développent progressivement dans le paysage académique français. S’il faut rester prudent sur les méthodes d’enquête employées, on estimait en 2013 que 94 % des établissements de l’enseignement supérieur étaient sur les réseaux contre 68 % 2 ans plus tôt (étude Arces, 2013), et du côté des organismes de recherche, cette présence est même considérée comme « incontournable » (étude Wanacôme, 2012). Du côté des chercheurs proprement dits, 70 % utiliseraient les réseaux sociaux (étude CNRS, 2013), contre 42 % en 2011 (étude URFIST de Nice, 2011). Mais toutes les études soulignent, d’une part, une certaine méconnaissance des réseaux sociaux spécifiquement académiques, au profit de Facebook et Twitter par exemple, et d’autre part, l’extrême dispersion des informations et des réseaux – les sciences informatiques et les SHS utilisant ainsi plus les réseaux sociaux que d’autres disciplines.
Il est difficile aujourd’hui d’avoir une idée précise du nombre de réseaux sociaux académiques existants dans le monde, tant ils se sont multipliés ces cinq dernières années, depuis les grands réseaux généralistes (Academia et ResearchGate) jusqu’aux réseaux de niche (Malaria World…), en passant par les réseaux thématiques (Biomed Experts, MyScienceWork).
Parmi tous ces réseaux, trois sortent plus particulièrement du lot :
Derrière les chiffres annoncés, on aimerait cependant connaître le taux d’engagement réel. Rappelons que dans le cas de Twitter, au moins 20 % des comptes seraient inactifs, et que les principaux réseaux sociaux, comme Facebook ou Google+, communiquent plus maintenant en terme d’utilisateurs actifs que de nombre d’inscrits…
Un contexte de recherche toujours plus concurrentiel et précaire, la recherche d’une meilleure visibilité tant des institutions que des chercheurs, des services personnalisés et l’intérêt aussi pour les métries et l’auto-évaluation expliquent sans nul doute cet engouement récent pour les réseaux sociaux académiques. Néanmoins si les dernières journées d’étude et les débats sur ces questions insistent bien sur l’utilité de ces réseaux et leurs enjeux2, ils se placent souvent davantage du point de vue du chercheur ou de l’institution3 que de celui des réseaux sociaux eux-mêmes.
Communauté, partage et visibilité. Tant les slogans que le discours de leurs fondateurs4 se placent dans la droite ligne des préoccupations des chercheurs. Il faut dire que ces fondateurs étant eux-mêmes des (anciens) chercheurs, ils ont une certaine connaissance du contexte. Mais dans le même temps, ne nous leurrons pas : les sociétés derrière ces réseaux ne sont nullement des philanthropes et ont (aussi) des préoccupations financières. À l’heure actuelle, peu de réseaux sociaux bénéficient de fonds publics – citons à titre de contre-exemple AgriVivo, projet initié et mené par le GFAR (Global Forum on Agricultural Research), en collaboration avec l’université de Cornell et la FAO. Academia a levé depuis sa création 17, 7 M $, tandis que la troisième levée de fonds de ResearchGate au printemps dernier s’est monté à 35 M $, en intéressant Bill Gates lui-même. Quant au petit poucet MyScienceWork, après une première levée de 1,2 M. € provenant d’une part d’un fond d’investissement et d’autre part d’une subvention publique, il espérait lever fin 2013 entre 6 et 8 M. € supplémentaires. L’enjeu est bien pour toutes ces entreprises de « faire fonctionner […] [un] business model rentable » (Tristan Davaille, de MyScienceWork). Si, pour l’instant, au contraire des réseaux sociaux professionnels de type LinkedIn, les réseaux sociaux académiques sont gratuits, ils ne repoussent pas l’idée de services payants à l’avenir, comme des partenariats commerciaux avec des entreprises industrielles pour ResearchGate. De son côté, MyScienceWork envisage une offre premium où « l’accessibilité à certains articles serait alors payante moyennant un forfait avec des fonctionnalités supplémentaires ». Que l’on s’en offusque ou que l’on y voit l’opportunité de développer de tels services, ces quelques exemples illustrent bien la part toujours plus importante des capitaux privés dans le monde académique.
Autre question que devrait se poser tout utilisateur de service en ligne, celle du contenu et de la propriété des données. Et l’on ne s’étonnera guère de voir dans les terms d’Academia que l’inscrit « grant to Academia.edu a worldwide, irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, to use, view, copy, adapt, modify, distribute, license, sell, transfer, publicly display, publicly perform, transmit, stream, broadcast and otherwise exploit such Member Content only on, through or by means of the Site or Services ». Et pour MyScienceWork, dont les articles et pages sont placés sous licence Creative Commons, cela s’applique-t-il à la partie réseau social également ou seulement au blog ?
Quant à la protection du droit d’auteur, même si ces réseaux donnent la possibilité de demander le retrait d’articles en cas de non-respect du droit d’auteur, on ne peut pas dire qu’Academia et ResearchGate fassent beaucoup d’efforts pour contrôler les téléchargements de fichiers a priori, reprenant ainsi les modes de fonctionnement d’un YouTube par exemple. A la question « Do I have copyright to upload papers to my profile page? » la FAQ d’Academia répond simplement : « According to Sherpa , which tracks journal publishers’ approach to copyright, 90% of journals allow uploading of either the pre-print or the post-print of your paper »… Quant à l’origine des données moissonnées, Stéphane Pouyllau soulignait récemment que MyScienceWork n’indiquait pas l’origine des publications retournées par le moteur de recherche, quand bien même elles étaient sur des plateformes d’archives ouvertes, et allait jusqu’à parler d’une « certaine privatisation du savoir ».
A l’instar des évolutions d’interface de Facebook ou de Twitter, nombre de ces réseaux donnent déjà l’impression, voire nécessitent de devoir s’inscrire pour accéder au contenu ou aux profils détaillés. On ne peut qu’être un peu étonné que la consultation de MyScienceWork, spécialisé dans le contenu en libre accès, nécessite une inscription, toute gratuite soit-elle ; il est vrai que c’est le seul moyen pour avoir des suggestions personnalisées. Or, la question est loin d’être anecdotique : si les profils de réseaux sociaux sont mieux références sur Google et que la visibilité des papiers d’un chercheur est meilleure sur les réseaux sociaux que sur des plateformes d’archives ouvertes, quel intérêt aurait-il à déposer sur ces dernières ? Et dans le scénario du pire – si les chercheurs déposent plus volontiers sur les réseaux sociaux ou si l’un des réseaux sociaux devient dominant -, c’est l’ensemble du système des plateformes institutionnelles et des archives ouvertes qui pourrait être remis en cause (Centre for Research Communications, University of Nottingham, 2011, point 5.4 notamment). Situation qui ne manquerait pas d’avoir de graves conséquences également si ces réseaux rendaient alors accessibles leurs contenus, au mieux, aux seuls abonnés, au pire, contre une forme ou une autre de monétisation au chercheur ou un rachat par des prédateurs – le rachat de Mendeley par Elsevier s’élevait à 45 M. £. Néanmoins, elles sont encore peu nombreuses les institutions qui, à l’instar du laboratoire lyonnais Triangle (UMR5206), indiquent comme bonne pratique à leurs personnels de ne déposer sur Academia qu’un lien vers le texte dans HAL ou sur le site des revues. Au vu du turn-over rapide de ce genre de plateforme jusque-là (qui se souvient de Labmeeting, UniPHY ?), c’est bien de l’accessibilité et de la pérennité des données scientifiques qu’il s’agit.
Enfin, on aimerait connaître les services que ces réseaux envisagent de développer à destination des chercheurs, car, pour l’instant, les services proposés se fondent totalement dans les pratiques académiques actuelles, en mettant l’accent avant tout sur les éléments quantitatifs. Academia propose ainsi un certain nombre d’analytics sur le nombre de vues des profils, des documents… Mais dans ce domaine, c’est sans doute ResearchGate qui est à la pointe avec son indicateur RG Score, lancé à l’été 2012 et qui vise à mesurer la réputation académique des chercheurs en fonction de leurs contributions et de leurs interactions dans le réseau. Si les données de ce RG Score sont largement à relativiser, il n’en demeure pas moins que ResearchGate montre bien dans quelle direction se développent désormais les métries, celle de l’auto-évaluation. Mais loin de remettre en cause le système actuel, il doit être, de l’avis même de ResearchGate, « used in combination with other metrics ». Et une nouvelle fois, difficile de ne pas voir les arrière-pensées commerciales d’un tel réseau, à l’image d’un Thomson-Reuters et son Impact Factor… Deux écueils apparaissent alors clairement. D’une part, mais ce n’est pas une nouveauté, on peut craindre que de tels métries incitent les chercheurs à développer leurs recherches dans les domaines les plus populaires (cf. témoignages sur Academia) – or, comme le rappelle avec humour, Frédéric Clavert, « si Febvre et Bloch s’étaient souciés de leur RGScore, ils n’auraient pas fondé l’école des Annales ». D’autre part, on peut craindre que « des entités privées deviennent les acteurs centraux de l’e-réputation scientifique » (Bastien Guerry).
Que l’on ne se méprenne pas, le but ici n’est pas de jeter le bébé avec l’eau du bain ; plusieurs études montrent en effet tout l’intérêt des outils 2.0, dont les réseaux sociaux font partie, comme complément des pratiques traditionnelles en matière de communication scientifique (étude RIN, 2010) et en matière de veille et de recherche 5. La question centrale est de pouvoir utiliser ces réseaux en connaissance de cause. Or, par bien des aspects, les enjeux des réseaux sociaux ne sont pas sans rappeler les questions liées à l’open access et à la gestion des données de la recherche ; car ce qui explique également le développement de ces réseaux, c’est le manque de connaissance et de visibilité des archives ouvertes auprès des chercheurs. Dès lors, c’est aux institutions et aux knowledge intermediaries de poursuivre, encore et toujours, la veille et l’information/formation sur ces problématiques (Rob Procter et al., 2010 et Françoise Gouzi). De fait, ces outils ne sont pas des outils scientifiques professionnels6, et il convient d’avoir conscience de leurs limites pour ne pas y investir plus de temps et de données que nécessaire.
Ne nous leurrons pas : à l’heure actuelle, ces réseaux n’ont pas de concurrent institutionnel valable – les différents projets envisagés de réseaux aux Etats-Unis ou en Allemagne ou encore les projets français autour des humanités numériques ne semblent pas avoir abouti. Et même si l’idée d’une couche sociale dans HAL (v3 de HAL, projet IDHAL , prévue au printemps)7, est séduisante, elle n’aura aucun sens si elle ne propose pas le genre de services qui font la force de ces réseaux comme les suggestions personnalisées, et ne favorise pas l’interopérabilité avec d’autres services étrangers. Dès lors, « un effort coordonné de nos tutelles s’impose pour le promouvoir plus fortement, quitte à mettre en avant les interactions possibles de cet outil avec les réseaux sociaux » (Eric Verdeil).
Et pourtant, ce genre de service pourrait créer de véritables valeurs ajoutées pour le chercheur et son institution. A l’heure du Big Data, de l’e-science etdes Digital Humanities, on pourrait en attendre des fonctionnalités plus développées que de simples métries ou des suggestions à la Amazon, et, quitte à utiliser nos données ou des données en open access, pourquoi ne pas envisager, comme certains le font ici, là ou encore là, de les voir proposer des modèles payants (selon le principe du freemium) pour le chercheur (gestion de l’identité numérique, outils de visualisation, suggestions plus poussées via le text-mining, achat de documents sous droits voire aide au recrutement) ou les institutions (conseil et formation, collections institutionnelles, outils analytiques poussés, lien vers les ressources de l’institution via OpenURL, organisation d’événements8…). Car les institutions aussi peuvent profiter de ces réseaux – l’IHA (Institut historique allemand), par exemple, dispose de comptes sur Academia pour valoriser ses différentes collections numériques. À condition cependant que ces plateformes et les institutions publiques partagent véritablement les mêmes politiques et les mêmes intérêts pour le bénéfice de tous, et non celui des seuls investisseurs…